
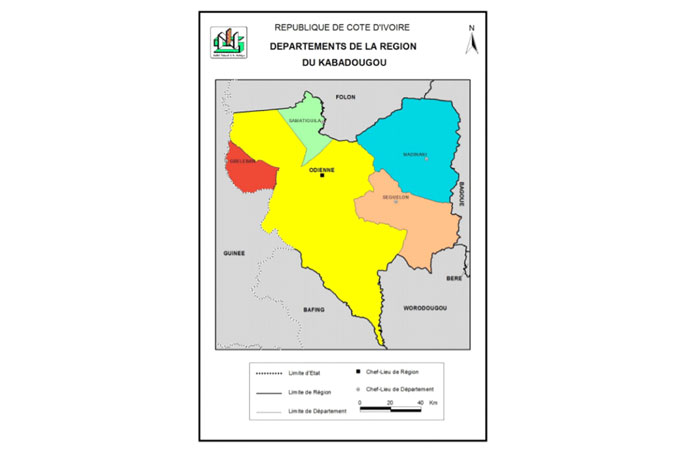
: Kabadougou
Situation géographique
La région du Kabadougou, l’une des composantes du district
du Denguélé, est située dans le nord-ouest de la Côte d’Ivoire. Elle est l’une
des trente et une (31) régions administratives du pays et couvre une superficie
de 14 000 km2 soit 6% du territoire national.
La région du Kabadougou est limitée au nord par la région du
Folon, à l’est par la région de la Bagoué, à l’ouest par la République de
Guinée et au sud par les régions du Bafing et du Worodougou. La ville
d’Odienné, chef-lieu de la région du Kabadougou, est située à 850 km
d’Abidjan, la capitale économique et à 550 km de Yamoussoukro, la capitale
politique du pays.
Le relief est dominé par les plateaux avec la présence de
massifs montagneux dont le Mont Denguélé culminant à 806 m d’altitude. Le
climat est de type tropical avec un régime soudano- guinéen à deux saisons :
– une saison pluvieuse qui s’étend de juin à novembre ;
– une saison sèche qui s’étend de décembre à mai, assorti
d’harmattan.
La pluviométrie a atteint des points de 1600 mm de
précipitations annuelles, régulièrement réparties. Plusieurs cours d’eau
arrosent par ailleurs la région. Les températures annuelles varient de 21°C Ã
35°C, avec des amplitudes thermiques moyennes de 26.5°C.
Le Kabadougou est l’une des régions les plus oxygénées du
pays, par la répartition équilibrée de ses forêts classées.
La région du Kabadougou est l’une des régions les plus
pourvues en ressources hydrauliques. Trois bassins versants d’envergure y sont
présents. Il s’agit du bassin du cours d’eau Baoulé important affluent du fleuve
Niger, du bassin du fleuve Sassandra qui prend sa source dans le Kabadougou et
du bassin versant du fleuve Bandama.
Trois bassins de cours d’eau et leurs nombreux affluents
arrosent tout le Kabadougou du nord au sud pour le Sassandra et le Bandama, et
du sud vers le nord pour le Baoulé, important affluent du fleuve Niger. Les
pluies y sont également abondantes, puisqu’elles atteignent parfois 1200 mm en
moyenne par année. Le potentiel cumulé des eaux de ruissellement, souterraines
et pluviales est suffisant pour garantir un approvisionnement intégral et
satisfaisant des populations du Kabadougou en eau potable et en énergie
hydraulique.
La région du Kabadougou est dotée de treize (13) forêts classées disséminées sur l’ensemble de son espace géographique. On y trouve de nombreuses espèces animales comme : les antilopes, les phacochères, les panthères, les agoutis, les singes, etc.
Situation démographique
La région du Kabadougou est peu peuplée et près de 4
habitants sur 5 vivaient en dessous du seuil de pauvreté en 2008 (Confère
DSRP, 2008). A ce jour, cette population est estimée à environ 193 364
habitants. Au plan de la chefferie traditionnelle, le Kabadougou comprend neuf
(09) cantons. La densité de la population dans le Kabadougou était de
11.5 habitants au kilomètre carré. Ce taux est estimé à présent à 17,9
habitants au kilomètre carré. Un indicateur qui reste largement en dessous de
la moyenne nationale (69 habitants). La principale langue d’échange des populations
autochtones (92.5%) est le Malinké.
Organisation administrative
La Région du Kabadougou compte cinq (05) départements et
quinze sous-préfectures répartis comme suit :
– département d’Odienné : cinq (05) sous-préfectures
(Bako, Bougousso, Dioulatièdougou, Odienné et Tiémé) ;
– département de Madinani : trois (03)
sous-préfectures (Fengolo, Madinani et N’Goloblasso) ;
– département de Séguélon : deux (02) sous-préfectures
(Séguélon et Gbongaha) ;
– département de Gbéléban : trois (03)
sous-préfectures (Gbéléban, Samango et Seydougou) ;
– département de Samatiguila : deux (02)
sous-préfectures (Samatiguila et Kimbirila au sud).
Aspects économiques
La région regorge d’énormes potentialités économiques :
Le secteur primaire
Les initiatives agricoles constituent l’essentiel de
l’activité économique de la région du Kabadougou. Le système d’exploitation
agricole est en général de type familial et traditionnel. Cependant à travers
les groupements informels à caractère communautaire au niveau des femmes et des
jeunes, on enregistre une amorce dynamique à vocation pré-coopérative.
Les principales cultures du Kabadougou sont : le riz,
l’igname, le maïs, le mil, le sorgho, le fonio, la patate, le manioc, et
l’arachide. Les cultures maraîchères principalement réalisées par les femmes
sont : la tomate, l’oignon, les choux, la salade, le gombo, l’aubergine, le
piment, la carotte. Les cultures spéculatives sont : le soja, la mangue, le
citron, la papaye, le gingembre, l’orange, la noix de karité. Le coton et
l’anacarde produits sur de grandes superficies constituent la spéculation en
plein essor dans la région.
La zone se prête à l’agro-pastoral qui est pratiquée
aujourd’hui de manière traditionnelle. Le cheptel se composait il y a une
dizaine d’années de bovins, ovins, caprins et volailles. La possibilité de
développer cette activité existe car le climat, la végétation, la disponibilité
des terres se prêtent à la création de fermes modernes associant agriculture et
élevage.
L’apiculture se fait de manière traditionnelle pour les
besoins de consommation domestique. Cependant, il existe deux groupements
d’apiculteurs de 80 personnes dans la région. La pêche se fait de manière
traditionnelle, mais la présence de plusieurs cours d’eau peut favoriser le
développement de cette activité avec l’appui des investisseurs.
L’exploitation du bois, des feuilles, des écorces et des
racines des essences forestières pour les besoins quotidiens (bois de service,
bois d’énergie, bois d’œuvre et pharmacopée) augmente proportionnellement par
rapport à la démographie.
Secteur secondaire
Bien que le potentiel de développement d’une activité
industrielle structurée existe, le Kabadougou continue d’être le champ
d’expérimentation d’une activité de transformation des produits locaux.
En effet, les opportunités de création d’unités
industrielles opérationnelles existent. Par exemple, il est noté la
transformation sur place du soja tel que le lait de soja, le pain de soja, le
yaourt de soja, les tourteaux de soja, l’huile de soja, etc., de la mangue, de
la tomate, du coton, de l’anacarde, du beurre de karité, du gingembre, du
citron, de la mangue, de l’hibiscus (bissap), de la pomme de terre, du sésame,
du miel.
En l’absence d’activités industrielles florissantes,
l’activité artisanale est très répandue. Aussi, trouve-t-on dans la région
plusieurs artisans dont :
– les forgerons qui fabriquent des outils de production
(dabas, haches, pioches, machettes, armes à feu traditionnelles et modernes,
flèches sagaies, etc.) ;
·
les potières qui fabriquent des pots Ã
fleurs, canaris, vase à encens, petits mortiers, objets de décoration ;
·
les tisserands qui produisent les
vêtements traditionnels à base du coton,
·
les menuisiers, les maçons, les
cordonniers, les tailleurs, les fabricants de vanniers, de cordes, nattes et
filets de pêche, etc.
La prospective géologique révèle des indices d’or, de
nickel, d’étain, de colombo, de tantalite, de chrome et une forte amplitude de
manganèse. De nombreux indices miniers y ont été répertoriés et dont la
connaissance approfondie débouchera sur l’exploitation des substances telles
que l’or, le diamant, le manganèse, le cuivre, le nickel, le colombo tantalite,
le molybdène, etc. Mais à ce jour, seul un important site pourvu de substances
minérales a été développé dans le Kabadougou, il s’agit de Zévasso pour l’or.
L’ensoleillement dans le Kabadougou qui est de l’ordre de
2500 heures en moyenne par an est un véritable gisement solaire très peu et mal
exploité à ce jour. Seule la localité de Baradjan située dans la sous-
préfecture d’Odienné est munie de panneaux solaires qui assurent l’éclairage
public du village.
Le secteur tertiaire
Dans la région du Kabadougou, il existe d’importantes
infrastructures socio-économiques de base : tics, eau courante, hôtels,
restaurants, routes, banques, assurances, électricité, structures académiques,
structures sanitaires, ONG, etc.
Aspects sociaux
La région du Kabadougou compte des infrastructures
académiques composées d’établissements préscolaires, secondaires (collèges et
lycées), techniques et professionnels (Lycée professionnel d’Odienné, Centre de
formation professionnel, Atelier d’apprentissage et d’application) ainsi qu’un
établissement d’enseignement supérieur (Cafop).
Au plan des structures sanitaires, la région du Kabadougou
compte un Centre hospitalier régional, dix (10) centres de santé urbains,
vingt-deux (22) Centres de santé ruraux, et un hôpital des Sœurs italiennes. La
région dispose de nombreuses danses: le Didadi, le Yagba, le Brou, le Zolo, le
Djembé, le Balafon, le Ghôhô, le Ngoni et le Molon.